Actions
Membre du bureau de L’ANEF

Association nationale des Études féministes https://www.anef.org
Organisation de rencontres :
Colloque Femmes d’à côté, Université de Lorraine, 2014

https://factuel.univ-lorraine.fr/node/1883
Colloque Résistances au féminin. Écriture contemporaine de l’engagement , Bibliothèque de l’Arsenal, 2018
https://bnf.hypotheses.org/2939
Colloque consacré à l’oeuvre de Benoîte Groult, Université d’Angers,

Participations
Séminaires Gradiva
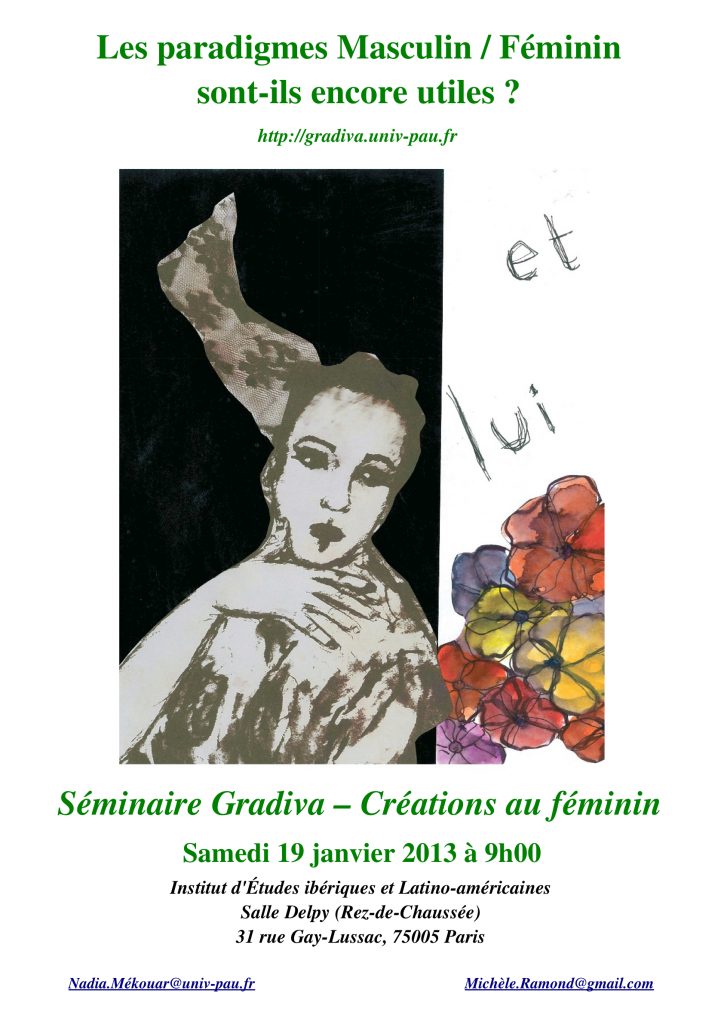
Est’ELLES

Publications
FEMMES EN RÉSISTANCE, Paroles et actes politiques,
Sous la direction de Sylvie Camet et Isabelle Mons, L’Harmattan, Paris, 2019

FEMMES D’A COTE, Filles, soeurs, épouses d’hommes célèbres
Sous la direction de Sylvie Camet, Minard, Paris, 2018

Benoîte Groult, Le genre et le temps, PUR 2016 :
À s’insinuer frauduleusement dans la correspondance inédite échangée entre Benoîte Groult et Hélène Dupuis, on découvre un cheminement emblématique de ce qu’a été l’éducation des jeunes filles dans cette société bourgeoise de la première moitié du XXe siècle. Autour d’elles s’articule un débat orienté par la conviction naissante qu’on ne peut plus les écarter de toute formation intellectuelle, mais que cette formation ne doit en aucun cas contrevenir aux prérogatives du mari destiné à prendre en charge leur vie. Ce dilemme se résume en deux injonctions contradictoires, un père qui se lamente en mai 1940 devant la déception d’un ajournement à l’université : « Je crois que je m’étais trompé sur tes capacités mentales. Si tu veux être gardeuse d’oies ou manucure, lâche tout, il est encore temps !!! » (p. 95) ; et une mère qui, en septembre 1940, découpe en pensée pour sa fille – chargée de faire la queue dans le froid devant les magasins d’alimentation – le manteau « très croisé, montant jusqu’au cou et le pan rabattu sur le côté du cou passé dans une boucle comme une boucle de ceinture. La même boucle avec ceinture à la taille. Un peu bouffant, puis droit à peine, élargissant vers le bas. Très chaud et ouatiné » (p. 126). Si André Groult ne dédaigne pas que Benoîte obtienne quelque diplôme – mais n’en fait pas non plus une obsession puisqu’il ne s’agit pour celle-ci que d’un accessoire –, Nicole Poiret, dessinatrice de mode, pense sa fille comme un modèle, elle voudrait la voir figurer dans le monde, qu’elle répande autour d’elle les formes de la grâce. Aussi bien d’ailleurs l’instruction superficielle n’est-elle que l’un des moyens d’obtenir la soumission des filles ; l’habitude du luxe en est une autre et, sur ce point, rien n’a changé. Donner de bonne heure à la fillette le goût des toilettes, du décor, de la représentation, c’est-à-dire des plaisirs les plus futiles et les plus dispendieux ; l’habituer à les obtenir sans effort : en faire une drogue occupant le vide de son existence et dont elle ne pourra plus se passer ; tel a toujours été, et tel est encore, le meilleur moyen de s’assurer des enfants dociles. La vie de la fille de bonne famille s’écartèle entre les couples contradictoires que sont : éveiller/éteindre, susciter/annihiler, enflammer/essouffler. Si la morale appliquée au féminin s’assouplit, les principes demeurent, et comme le note Claude Alzon, dans le même temps l’éducation des garçons s’affine, si bien qu’entre le bourgeois technocrate de ce premier XXe siècle et son épouse ayant suivi ses humanités, ily a autant d’écart qu’entre l’industriel du XIXe siècle ignorant et son épouse laissée niaise. C’est pourquoi la lecture de la correspondance entre Benoîte (qui s’appelait encore Rosie dans sa jeunesse) et Hélène Demoriane, sa condisciple à la Sorbonne, est éminemment instructive. Le mouvement d’ensemble de cet échange d’une année, de 1939 à 1940, traduit l’effacement progressif des aspirations individuelles des deux adolescentes et leur entrée dans le rang. L’espèce de confession que constituent ces lettres sans témoins souligne exactement ce que note Simone de Beauvoir dans le chapitre du Deuxième Sexe qu’elle consacre à la jeune fille : « C’est une pénible condition que de se savoir passive et dépendante à l’âge où s’exalte la volonté de vivre et de prendre une place sur terre. » Dans ce moment charnière entre la subordination obligée de l’enfance et un moi qui cherche à se constituer dans l’autonomie, Rosie et Hélène oscillent sans cesse entre une confiance spontanée et le pressentiment que cette confiance est usurpée. Cantonnées de part et d’autre de la ligne Maginot, elles ont perdu l’occasion de leurs rencontres vivantes, cet éloignement forcé par les circonstances leur permet de consigner presque au jour le jour leurs réflexions et leurs émotions. Les lettres constituent leur espace de résistance, moins contre le nazisme que contre le machisme, ce dernier ne les guette pas seulement le temps d’une guerre, mais le temps d’une vie tout entière. Elles ont dix-neuf ans au commencement de leur liaison épistolaire et ce qu’elles disent de leur confinement traduit une évidente frustration : Benoîte affirme « je voudrais être un garçon. On a honte d’avoir les mains propres et soignées, un poudrier dans son sac ! » (p. 10) tandis que d’autres sont exposés aux violences les plus radicales. Elle ajoute : « Moi, malheureusement victime d’un préjugé idiot qui relègue à l’arrière le sexe dit « faible », moi je n’aurai contribué à la guerre qu’en tricotant trois paires de chaussettes par mois (et encore) et en écoutant les communiqués trois fois par jour. Je voudrais m’engager dans l’aviation » (p. 14). L’atmosphère apaisée de Concarneau aboutit à une expérience paradoxale : « Je vais à la pêche demain matin. Le sable est chaud. Je suis très brune. J’ai des fleurs dans les cheveux.

C’est gênant, c’est triste. J’aimerais être un garçon ces jours-là » (p. 5). La traversée d’une période particulièrement grave politiquement accentue l’impression d’en être tenue à une neutralité insignifiante, impression qui pourrait se transformer rétrospectivement en un sentiment de culpabilité. Par deux fois elle réclame d’appartenir à l’autre sexe, ce qui dans ce contexte où l’envie générale est plutôt à la démobilisation ou à la désertion, prouve combien la mise au ban de l’histoire est ressentie comme inacceptable. Ce que révèle cet aveu est que la mort brutale, mais signifiante, est encore préférable à ce ronronnement lénifiant. Les deux jeunes filles sont donc maintenues en dehors de l’événement et cette extériorité est aggravée par le fait qu’elles sont mineures aux yeux de la loi, c’est-à-dire que, bien qu’étudiantes, elles ont à vivre dans la dépendance totale à l’égard de leur famille : Benoîte Groult, relisant ces pages bien des années plus tard, écrit en marge du document : « La famille, toujours la famille », étonnée elle-même avec le recul que toutes les impossibilités énumérées dans les lettres viennent le plus souvent d’une autorité toute proche freinant désir et volonté d’action. La lecture du manuscrit communique cette vibration inexistante dans les textes imprimés, faisant ainsi deviner le conflit intérieur de l’auteure, qui laisse percer ici un certain effarement devant la subordination constante dont elle a été victime. La secondarité n’apparaît pas comme un phénomène naturel et acceptable, elle est présentée comme nocive, dommageable à l’équilibre psychique ; Rosie fait injonction à Hélène de s’exprimer sans contrainte dans ses lettres : Parlez de vous pendant mille et mille pages. Puisque, malheureusement, le Moi des jeunes filles en temps de guerre n’est plus de mise, et qu’il faut le faire entrer, étouffé et écrasé, dans le fin fond de sa besace. Ouvrons lui un peu sa cage dans nos lettres. Il deviendrait tout bossu et chétif si nous ne le laissions jamais s’étirer au soleil (p. 29). Les adjectifs, marqués de cet humour qui ne quittera jamais la narratrice, « bossu », « chétif », indiquent bien la conscience aiguë de la perte. Une fille qui grandit ne va pas en s’épanouissant mais en se racornissant sous l’effet de la brimade qu’elle subit. La lecture convainc qu’existait cette extraordinaire énergie, cet ardent désir qui ne demandait qu’à s’emparer des choses du monde et non à demeurer à sa place dans la sagesse, le repli et l’attente. Est-ce ainsi que les femmes vivent ? Malgré le poids de la tradition catholique, du respect inculqué pour les institutions à travers l’école et la famille, plusieurs passages expriment du dégoût à l’égard de ces conventions que l’entourage appelle à perpétuer : Femmes enceintes suivies de flocons de bébés. En face de moi un petit garçon de sept ans avec son père, un monsieur « comme il faut ». Le petit garçon à déjà l’air ponctuel et propret. Sans imagination et sans vices. Il mange un gâteau sec et déjà s’époussette soigneusement le ventre. Ça promet à sept ans. Rien de plus triste que la pluie dans une gare. Une dame très laide avec des crans lit un petit roman de train à 0,75. Une autre renifle. Ça sent le vieux parquet et la poussière des gares. Hélène, c’est immonde (p. 42). L’intonation est à la fureur, à la révolte devant l’espèce de condamnation qu’est cette existence sans joie, marquée par le seul traditionalisme. La correspondance dénonce incessamment cet impossible-là : être conforme. Se projeter dans un avenir qui ne serait que de vie domestique semble par avance un enfouissement, les images qui sont associées à cette perspective traduisent la décomposition et le pourrissement lent des espérances : Vous auriez une grande armoire un peu humide pour les draps, des confitures rouges et vertes, un napperon de dentelle sur le piano, en triangle et des bibelots dessus. Peut-être sur un canapé une de ces sinistres poupées de foire, très fardées avec des robes jaunes et noires et la tête plate. Un petit escalier qui sent le moisi et une chambre un peu comme une vieille chambre désaffectée, avec une petite odeur de momie flottante. Un grand lit très haut avec courtepointe (je ne sais pas ce que c’est qu’une courtepointe mais il y en aurait sûrement une !) et des photos et des lettres dans un coffret. Vous auriez, Hélène, une grande pendule triste dans la nuit. Et des assiettes posées verticalement sur le buffet. Et des petits coussins pour mettre sous les pieds. Et une chaufferette. Et une douillette. Et une moumoute et autres petits objets semblables. Des mitaines évidemment (p. 47).

Bien que chaufferette, moumoute, douillette soient des objets qui évoquent le confort et la chaleur, ils semblent suggérer plutôt l’idée du froid, un froid intérieur signifié par l’étroitesse de la maison lieu de clôture et d’épuisement. L’emploi du conditionnel suppose la négation mentale d’une telle perspective, mais l’histoire qui va s’enchaîner ne fera malheureusement que valider cette probabilité. Le fond de cette correspondance exprime une angoisse effective, l’entrée dans la destinée adulte d’une femme ne provoque aucune anticipation réjouie, au contraire, le vocabulaire choisi, l’ironie de la tonalité, l’étroitesse de la perspective, traduisent un véritable accablement et n’admettent aucune projection légère dans le futur. « La crise de l’adolescence c’est une sorte de « travail » analogue à ce que le docteur Lagache appelle « le travail du deuil ». La jeune fille enterre lentement son enfance, cet individu autonome et impérieux qu’elle a été ; et elle entre avec soumission dans l’existence adulte » dit Simone de Beauvoir, mais justement cette existence conçue par les adultes qui l’ont précédée a des traits si moroses et routiniers, qu’elle ne peut les accepter en héritage. De surcroît, elle ne percevra de cet héritage que la part la plus dérisoire : « Jeunes filles en ce temps-là était synonyme de jeune fille à marier » constate sobrement le personnage de Marion dans La Part des choses . La certitude nous vient que ces jeunes filles n’entrent pas naturellement dans leur état d’épouse, qu’il a fallu les y contraindre et que c’est au prix d’un dur renoncement qu’elles devront accepter le mariage et l’abandon d’une jeunesse qu’elles croyaient fertile en promesses. Avant d’être mariée, on a mille possibilités diverses de réalisation de soi-même. Puis on se marie, souvent mal. Et d’un coup on perd toutes ses autres possibilités, qui ne se réaliseront jamais maintenant. Et on les regrette, parées de l’auréole des rêves irréalisés. Puis on a des enfants. Et si on n’a pas d’argent, on est esclave. On ne peut pas aller au cinéma avec son mari, ni faire une croisière, ni aller en week-end chez des amis. Le mari est dégoûté des bébés qui ont la colique dans leurs berceaux et font dans leurs couches toutes les deux heures. Et qui crient quand il veut lire le journal. Et qui renversent ses encriers et abîment ses rasoirs en coupant des pieds de table avec. Alors ils s’en vont les maris, vers celles qui n’ont pas d’enfants criards à leurs trousses. Et la femme reste chez elle et met des savates et une vieille robe de chambre, et les enfants sentent le pipi parce qu’elle est trop triste pour les laver six fois par jour. Et elle pleure sous ses bigoudis (p. 63). Ces dernières lignes ont été écrites à la veille d’avoir vingt ans et l’on aurait envie de détourner la première phrase d’Aden Arabie de Paul Nizan, « je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie », en découvrant comment cette entrée dans une troisième dizaine s’apparente à une irrémédiable condamnation. Les épisodes décrits dans leur crudité semblent emprunter au genre du drame réaliste, la peinture de la femme délaissée relève manifestement d’un autre milieu social que celui des épistolières, mais la vivacité avec laquelle est montrée sa condition conforte plus violemment les intéressées dans l’idée qu’elles doivent se garder d’un avenir si dégradant.